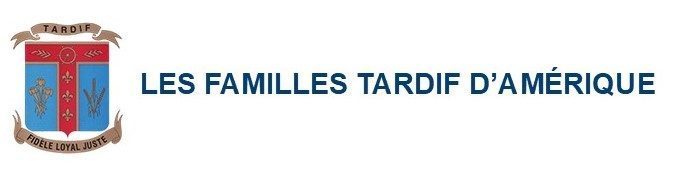Olivier Le Tardif est sans contredit l’ancêtre de la grande majorité des Tardif en Amérique. De nombreuses et courtes biographies ont été publiées à son sujet, la plupart basées sur les publications de Mgr Gosselin et de A. Ducharme, de plus il a inspiré un roman biographique Monsieur Olivier, paru en 2011, à Marc-André Tardif, le président fondateur de l’AFTA. Voici un court résumé de la vie d’Olivier Le Tardif, basé sur des recherches antérieures et récentes.
Olivier Le Tardif, fils de Jehan Le Tardif et de Clémence Houart, naquit à Étables, évêché de Saint-Brieuc en Bretagne, aujourd’hui Étables-sur-Mer. Il arrive à Tadoussac le 24 juin 1618 sur un navire de la «Compagnie des Marchands», parti de Honfleur le 24 mai. Lors de son enrôlement, Le Tardif avait la qualité «d’interprète» chargé de se mettre en relation avec les autochtones en ce qui concerne la traite des fourrures. Dès1621, il fait partie des notables de Québec avec qui il signe un document qui sera remis au roi Louis XIII concernant les conditions de vie en Nouvelle-France. Il passe quelques hivers à Québec et Champlain le dit interprète des langues indiennes et sous-commis au magasin de Québec. Le 20 août 1629 Champlain lui demande de remettre les clefs du magasin de Québec à Louis Kirke après la prise de la ville.
Ramené en Angleterre avec Champlain par les frères Kirke, il repasse ensuite en France où il s’établit temporairement à Honfleur. En arrivant en Angleterre, Champlain ainsi que les Kirke apprirent que la paix avait été signée le 24 avril 1629 et que la prise de Québec qui eut lieu après cette date n’était sûrement pas valide. Champlain, qui avait cédé la colonie le 20 juillet, fait donc des démarches ainsi que Le Tardif pour se faire remettre la colonie et tout ce qui avait été pris au magasin de Québec. En effet, le traité de St-Germain-en-Laye remettait le Canada à la France. Olivier est donc de retour à Québec dès 1631. Il est très actif car on voit son nom déjà sur quantité d’actes civils et religieux. En 1633 il est à Rouen où il donne une procuration au sieur Jean Rozée afin que ce dernier retire ses gages en son nom.
En 1634 il est qualifié de premier commis de la Compagnie des Cent-Associés dans un acte de partage de biens entre Guillaume Couillard, Hélène Desportes et Guillemette Hébert. En 1635 il assiste l’arpenteur Jean Bourdon dans une concession de terre à Abraham Martin. Le 17 novembre 1635 il signe comme témoin au testament de Champlain. Il travaille de près avec toutes les classes de la population. Il adopte trois enfants amérindiens (1 garçon et 2 filles) et paie pour leur logement et leur éducation. L’une d’elles, Marie Olivier Manitouabewich épousera en 1644, un français, Martin Prévost, ce qui constituera le premier mariage mixte de la Nouvelle-France.
Le 23 mars 1637, le gouverneur de Montmagny concède par indivis à Olivier Le Tardif et à Jean Nicolet 160 arpents de terre en bois, dite terre de Belleborne qui deviendra plus tard la Châtellenie de Coulonge qui sera la résidence des lieutenants gouverneurs de la province de Québec jusqu’en 1961.
En 1637, il épouse Louise Couillard, petite-fille de Louis Hébert; elle n’avait que douze ans et demi. Elle aura un fils quatre ans plus tard et mourra dans la même année. Son fils la suivra dans la tombe quelques années plus tard. Ce fils Pierre avait comme parrain nul autre que le gouverneur, monsieur Charles Huault de Montmagny.
On le voit ensuite assister à la prise de possession de l’Ile d’Orléans par le sieur Derré de Gand pour la Compagnie des Marchands, rendre témoignage dans l’enquête sur la mort par noyade de Pierre de la Porte, agir comme marguillier de Notre-Dame-de-Québec et signer comme témoin des douzaines d’actes de baptême, mariage, sépulture ainsi que des actes notariés. Il est en contact constant avec les Jésuites qui le mentionnent à plusieurs reprises dans leurs Relations.
En 1641 il devient commis général de la Compagnie des Cent-Associés et prend charge du navire le « Notre-Dame » appartenant à la compagnie; ses fonctions l’obligent à faire plusieurs voyages en France où il passe plusieurs hivers. Par exemple en 1643, il engage cinq hommes à La Rochelle pour Guillaume Couillard; en 1645 il est parrain d’Olivier Michel à La Rochelle; il assiste au mariage de Zacharie Cloutier en 1648 également à La Rochelle et à la fin de mai 1648, il s’y marie lui-même en secondes noces avec Barbe Esmard également veuve et mère d’Olivier Michel.
En avril 1646, Olivier avait été nommé procureur général de la Compagnie de Beaupré et co-seigneur de la côte de Beaupré pour la somme de 1500 livres. À ce titre, il devait concéder des terres aux futurs colons, régulariser les concessions accordées verbalement antérieurement, faire valoir les terres de la seigneurie et éventuellement, en tant que juge prévost ou bailli de la seigneurie, régler les mésententes survenues entre les habitants.
À son retour de France en 1648, marié et avec deux enfants, le sien Pierre et celui de sa femme, Olivier Michel, il s’installe sur la côte de Beaupré, au Cap Tourmente où il possède une maison et éventuellement à Château-Richer. Il s’applique à développer cette partie de sa seigneurie et de 1650 à 1651 il y attire une trentaine de concessionnaires dont plusieurs sont les souches des grandes familles canadiennes comme les Racine, Gravel, Bélanger, Boucher, Gagnon, Drouin, Giguère, etc.
En 1655, il vend une rente au sieur Jean Rozée et à cet acte est ajouté un billet explicatif apparemment fait de la main même d’Olivier Le Tardif. A part ses nombreuses signatures, ce billet serait le seul exemple que nous ayons de son écriture.
En 1656, se sentant probablement atteint de maladie, il donne une procuration à son épouse Barbe Esmard pour régir et administrer tous ses biens. Malheureusement celle- ci meurt trois ans plus tard, laissant quatre enfants d’âge mineur. Mais Olivier se rétablit partiellement car il est encore actif sur sa seigneurie; il fait de nombreuses concessions et il passe un grand nombre de contrats. Il est confirmé par Mgr de Laval en 1660. Il fait même un voyage en France où il signe un acte de concession en 1661 et s’occupe des familles de la Côté de Beaupré ruinées par les incursions des Iroquois.
Mais sa maladie progresse et en 1662 ne pouvant plus s’occuper de ses biens il vend sa terre et habitation de Château-Richer ainsi que ses droits seigneuriaux à Charles Aubert de la Chesnaye. On lui nomme un curateur pour administrer ses biens en la personne de François Bélanger; on nomme comme tuteur de ses enfants Zacharie Cloutier son beau-frère (son épouse Madeleine étant la soeur de Barbe Esmard). Il décède à Château-Richer et y est inhumé le 28 janvier 1665 après avoir joué un rôle de premier plan dans la colonisation et l’administration de la Nouvelle-France.
Sa fille Barbe-Delphine maria Jacques Cauchon le 23 novembre 1661 à Château-Richer et ils eurent de nombreux enfants. Son fils Guillaume est le seul qui continue la lignée Tardif. Après quelques années passées à Sillery, il s’installa définitivement à l’Ange-Gardien. Trois de ses fils, sur une famille d’environ dix enfants, eurent une descendance nombreuse et sont à la tête des trois branches principales de la famille Tardif:
● François: branche de Québec, Côte de Beaupré, Ancienne-Lorette, St-Augustin.
● Charles: branche de Kamouraska, Bas-du-Fleuve, Madawaska.
● Pierre: branche de Lévis et de la Beauce, etc.
Leurs nombreux descendants se retrouvent partout, principalement au Québec et en Nouvelle-Angleterre et, en moins grand nombre, dans les grandes villes du Canada et des Etats-Unis.